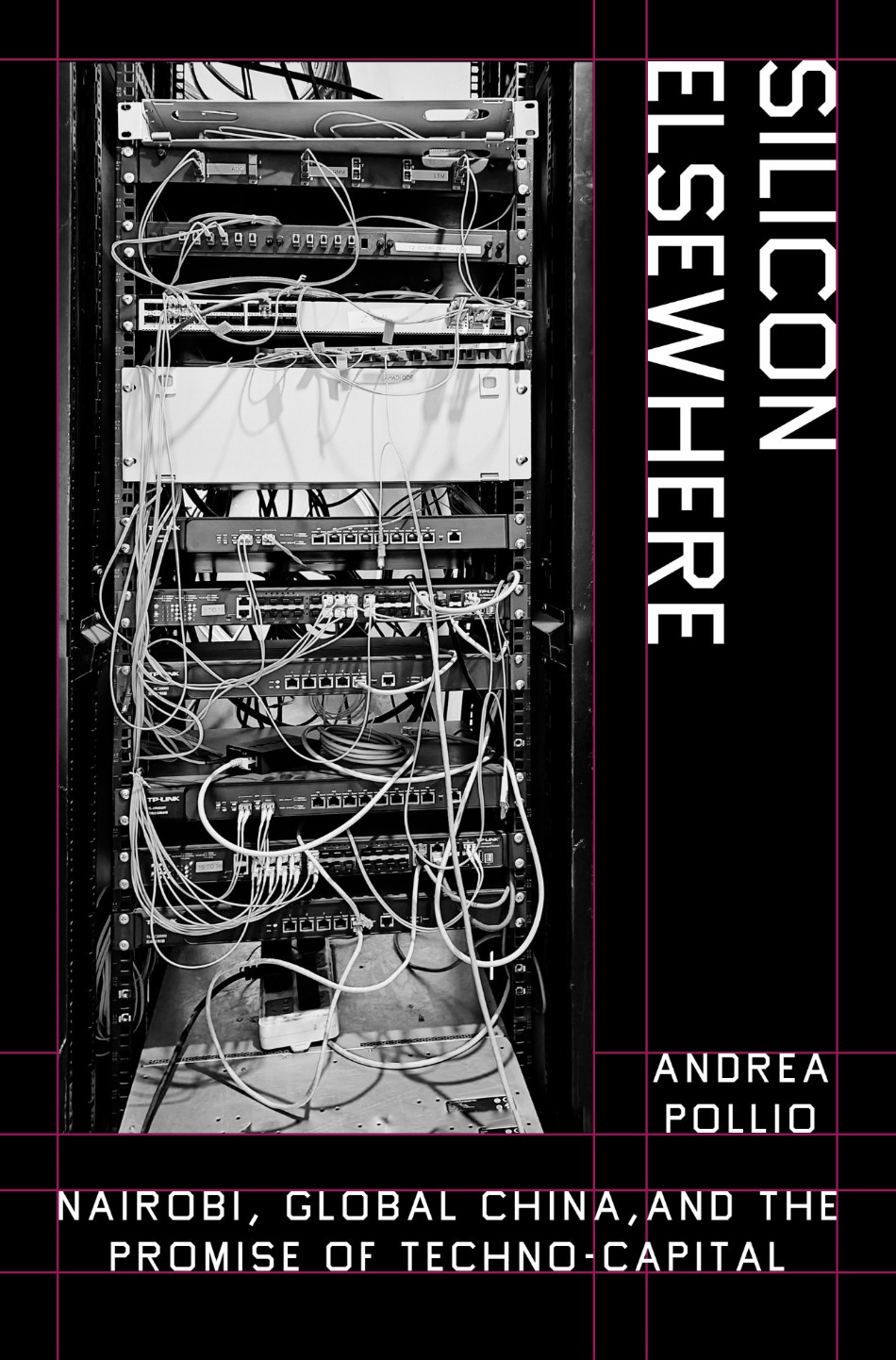Nairobi, capitale expérimentale du « techno-capital » chinois
Entretien avec Andrea Pollio, chercheur ethnologue.
Andrea Pollio est chercheur ethnologue à l’université de Turin en Italie et rattaché à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud. Il est l’auteur de Silicon Elsewhere: Nairobi, Global China, and the Promise of Techno-Capital. Il est aussi contributeur de l’excellent média Rest of World.
Son ouvrage (en anglais, disponible ici) nous éclaire sur l’inclusion chinoise dans la Silicon Savannah au Kenya, pays qui compte plus de 56 millions d’habitants. De l’assistance bancaire offert par Huawei au bouquet audiovisuel en langue locale diffusé par StarTimes, l’étude ethnologique d’Andrea confirme à la fois la conquête globale-locale de la Chine, suivant la logique « One Road One Belt » chère à Xi Jinping, mais elle tord aussi le cou aux clichés que l’on se fait sur l’Afrique et plus largement du Sud Global vu d’Europe. En entrant dans le détail, on en apprend davantage sur la façon dont la Chine contourne les marchés dominés par les Occidentaux, sur l’inclusion culturelle dont elle fait son moteur d’expansion, et sur les interstices de l’économie sociale qui l’aide à se faire “accepter” positivement des utilisateurs.
Les points clés du livre :
L’ouvrage en six chapitres détaille la façon dont la Chine a pénétré le marché digital chinois, et cela commence dans une banlieue de Nairobi, avec l’arrivée progressive des smartphones bon marché. Une approche qui a été rendue possible par le soutien à la construction de grandes infrastructures comme le réseau national de fibre optique NOFBI. Les Big Tech chinoises sont devenues omniprésentes au Kenya, des équipements réseaux aux applications grand public.
· Huawei et ZTE sont quasi dominants au Kenya, et ont joué un rôle prépondérant dans la digitalisation de l’économie kenyane. Huawei a ainsi construit l’infrastructure technique qui a permis la modernisation de l’application de paiement mobile M-Pesa, intégré à l’opérateur télécom Safaricom, et a développé le service de découvert bancaire Fuliza.
· La Chine a investi le marché des smartphones low cost avec Transsion Holdings (Tecno, Itel, Infinix), le plus grand fabricant de smartphones en termes de vente en Afrique. Transsion fabrique les téléphones en Chine à Shenzhen, en Indonésie, au Pakistan, en Ethiopie, au Bangladesh et depuis peu en Inde. Au Kenya, il a raflé plus de 60% de parts de marché en ciblant agressivement les segments d’entrée et de milieu de gamme avec des appareils abordables et adaptés aux besoins locaux (ex: double SIM, batteries longue durée, appareils photo optimisés).
· Le géant Alibaba est présent dans le e-commerce local. Son fondateur, Jack Ma, a effectué une visite très médiatisée au Kenya en 2017. Alibaba organise le concours « Africa’s Business Heroes » à Nairobi qui rencontre un vif succès.
· Opera est le navigateur web très populaire en Afrique pour sa faible consommation de données, il a été racheté par un consortium d’investisseurs chinois en 2016. Depuis, l’entreprise a lancé une stratégie « Africa-first », diversifiant ses activités au Kenya avec la plateforme d’actualités Opera News (l’application la plus téléchargée au Kenya en 2018) et des services de micro-prêt comme OKash.
· StarTimes est très populaire en Afrique et en particulier au Kenya et au Nigeria. Entreprise fondée en 1988 par l’ingénieur Pang Xinxing, StarTimes propose des services de TV numérique et terrestre. Présent dans 30 pays, elle comptait 13 millions d’abonnés en 2020, et cible au Kenya les familles modestes en proposant des abonnements low-cost. StarTimes a complété son offre TV avec des services mobiles, son application dédiée compte plus de 20 millions d’utilisateurs.

· TikTok est utilisé comme un outil de communication interne pour des start-ups chinoises au Kenya
Financement - La Chine est le deuxième créancier étranger du Kenya après la Banque mondiale. De nombreux projets d’infrastructure sont financés par des prêts d’institutions chinoises comme l’Exim Bank of China. Cette dépendance financière est cependant une source de débats et d’inquiétudes au Kenya.
Au-delà des prêts, on observe une augmentation des investissements directs, allant des grandes entreprises d’État aux petites start-ups et aux investisseurs en capital-risque (VC) qui voient Nairobi comme un terrain d’expérimentation idéal pour le marché africain.
Des entreprises comme UnionPay se déploient au Kenya, et des start-ups fintech fondées par des Chinois, comme Easytransfers, tentent de créer des corridors de paiement entre la Chine et l’Afrique.
Entretien avec Andrea Pollio:
Votre ouvrage présente Nairobi, la capitale du Kenya, non pas comme une périphérie mais comme une « capitale expérimentale ». Pourquoi présenter cette ville comme un lieu « expérimental », et qu’est ce qui la distingue des autres hubs technologiques émergents dans le monde ?
L’expérimentation est une caractéristique essentielle du capitalisme numérique en général. C’est à la fois une épistémologie — un mode de connaissance — et une pratique — un mode d’action dans le monde. En décrivant Nairobi comme une capitale expérimentale du changement technologique, je voulais démontrer que ces expériences ne se déroulent pas seulement dans un noyau imaginaire (disons, la Silicon Valley) pour ensuite être exportées vers une périphérie (dans ce cas, Nairobi). Mon argument n’est pas que Nairobi est exceptionnelle ou unique. Au contraire, si nous voulons comprendre les transitions mondiales en cours dans la technologie et la politique, nous ne pouvons pas ignorer ce que des hubs comme Nairobi nous offrent comme point de vue — une géographie d’expériences où de nouvelles formes techno-économiques naissent et émanent réellement.
Vous parlez de « Silicon Elsewhere ». Selon vous, quels sont les principaux dangers ou écueils de l’application du modèle de la « Silicon Valley », à un contexte aussi unique que Nairobi ?
Le principal danger, c’est la reproduction du trope selon lequel il n’y a qu’un seul centre du monde numérique et que tout ce qui se passe ailleurs est une affaire dérivée. Nous ne pouvons pas ignorer le pouvoir que la Silicon Valley exerce sur notre imagination ; après tout, la scène technologique de Nairobi est en effet surnommée la « Silicon Savannah ». Nairobi emprunte son surnom à la Californie (et nous pouvons citer d’autres exemples de « localités » Silicon, de la lagune de silicium de Lagos au Nigeria, ou au cap de silicium de Cape Town en Afrique du Sud). Mais les réalités ne sont jamais contraintes par les métaphores qui les encadrent. En centrant la « connexion pékinoise » de Nairobi, j’espère déprovincialiser la Silicon Savannah et montrer qu’il s’agit d’un site expérimental où les formes technologiques sont réinventées par des rencontres avec des idées, des modèles commerciaux et des équipements chinois, plutôt que d’être simplement une piste d’atterrissage passive pour les ambitions étrangères.
Une idée clé de votre livre est le rôle de « l’infrastructure invisible » des smartphones chinois abordables. Jusqu’où cette approche permet à la Chine de jouer de son influence ?
(…) Nous devons nous concentrer sur le matériel et le logiciel ensemble. En les tenant côte à côte, nous voyons comment le passé industriel récent de la Chine façonne sa présence numérique au Kenya. Par exemple, se concentrer sur les téléphones abordables de Transsion — souvent rejetés comme des contrefaçons de qualité inférieure — révèle que ces appareils ne sont pas seulement des copies « déversées » ; ils sont souvent expérimentés à Nairobi, avec des équipes locales de recherche sur les utilisateurs. Alors que les géants occidentaux comme Alphabet ou Meta sont des concurrents presque inattaquables dans certains secteurs de l’économie numérique, des entreprises chinoises comme Transsion se taillent de nouveaux espaces de domination du marché avec leur marketing de masse qui associe appareils et écosystèmes logiciels. Seyram Avle et Miao Lu ont tous deux mené des recherches approfondies et remarquables à ce sujet. Dans le livre, je mentionne également brièvement StarTimes, qui domine le marché de la télévision payante en Afrique rurale. StarTimes est un autre bon exemple où les avancées combinées dans les logiciels (même très progressives) et le matériel ont créé une solution de plateforme abordable pour les téléspectateurs de la télévision gratuite.
Votre travail décrit la relation Chine-Nairobi comme une interaction complexe de « coproduction », et non une simple dépendance. Sur la base de votre travail ethnographique, où traceriez-vous la ligne entre un partenariat pragmatique et les dynamiques néo-coloniales que certains critiques tendent à souligner ?
Je pense que cette ligne dépend de la façon dont nous définissons le néocolonialisme. S’il s’agit d’un synonyme des inégalités mondiales qui sont le résultat d’un passé colonial, alors presque tout ce qui se passe sur le continent africain aujourd’hui peut être décrit comme un palimpseste de relations néo-coloniales. Mais j’aime la définition plus précise de l’ancien dirigeant ghanéen Kwame Nkrumah, pour qui des formes très spécifiques de dépendance caractérisent ce qu’il appelait la « dernière étape de l’impérialisme » : lorsqu’un État qui possède tous les symboles supposés de l’indépendance — un drapeau, une constitution et un siège à l’ONU — voit pourtant sa réalité interne régie par des forces économiques redevables à l’ancienne puissance colonisatrice. Pour Nkrumah, cela se produisait par le biais de la monnaie, de la dette à taux d’intérêt élevé, de la manipulation commerciale et, parfois, de la présence militaire, garantissant que les anciennes colonies restaient un fournisseur de matières premières bon marché et un marché captif pour les produits étrangers, sans la responsabilité morale d’un régime direct.
Si nous nous en tenons à cette définition, la présence de la Chine globale dans la Silicon Savannah peut ou non correspondre à ces caractéristiques. Comme je le soutiens dans le livre, plutôt qu’une simple histoire de domination à sens unique, ce que nous voyons à Nairobi est un mariage de convenance entre différentes aspirations. En fin de compte, reconnaître Nairobi comme un « Silicon Elsewhere » nous oblige à la voir comme une géographie de la technologie à part entière, où de nouvelles formes techno-économiques sont activement négociées, plutôt que comme une simple frontière à conquérir.
Comment les entrepreneurs, les développeurs et les utilisateurs kényans perçoivent-ils réellement l’influence du capital et de la technologie chinois ? Est-ce considéré davantage comme une opportunité, une menace ou un mélange complexe des deux ?
Je pense que cela dépend de la personne qui vous le demandez. La présence de la Chine numérique est un terrain de compromis et de réponses diverses. Il est clair que le gouvernement kényan, par exemple, a adopté une position résolument positive et pragmatique, considérant les partenariats chinois comme essentiels à la croissance axée sur les infrastructures envisagée dans Kenya Vision 2030. Les entrepreneurs — du moins ceux à qui j’ai parlé — étaient également très pragmatiques. Ils voyaient souvent la Chine non seulement comme une source de capital, mais aussi comme une source de nouveaux apprentissages sur la technologie de résolution de problèmes et les modèles de marché de masse que le capital-risque occidental ignore souvent.
Quant aux utilisateurs ordinaires, cela dépend aussi. Certaines technologies deviennent plus invisibles que d’autres, de sorte que même leur « chinoisité » se dilue. Dans ces cas, le matériel ou la plateforme est jugé principalement sur sa valeur fonctionnelle — son prix abordable, sa réparabilité et sa capacité à optimiser la vie urbaine. D’après mon expérience, les Nairobiens sont beaucoup plus virulents sur les pièges et les périls de la présence chinoise lorsqu’il s’agit d’autres secteurs de l’économie, comme la construction et l’immobilier.
La montée de l’économie des petits boulots (gig economy) et l’exploitation dans des secteurs comme la modération de contenu représentent un côté plus sombre du boom technologique. Dans quelle mesure avez-vous observé cette précarité, et comment remet-elle en question la « promesse du techno-capital » plus optimiste mentionnée dans votre sous-titre ?
La précarité, et même la jetabilité, sont des caractéristiques de la vie à Nairobi. Mon argument le plus critique dans le livre est que les promesses émancipatrices du techno-capital sont souvent fondées sur et rendues possibles par l’existence même de cette précarité omniprésente. Pourtant, cela ne signifie pas que le techno-optimisme n’est pas puissant parce qu’il est défectueux ; c’est un moteur ambivalent avec lequel nous devons compter précisément parce qu’il se nourrit de ses propres contradictions.
De votre point de vue, l’État kényan est-il un acteur souverain en contrôle, ou a-t-il du mal à suivre ?
Le cas kényan est peut-être unique, car le pays dispose d’un ensemble très complet de lois et de réglementations concernant le traitement des données, ainsi que de protocoles pour maîtriser les startups technologiques incontrôlées qui exploitent les failles juridiques. L’exemple récent du VASP (Virtual Asset Service Providers, une nouvelle loi qui encadre l’intégration des crypto-actifs, des stablecoins, et des services associés dans l’économie numérique nationale, NLDR) est révélateur, en ce qu’il a créé un ensemble de règles très sophistiquées pour la finance décentralisée (comme la crypto). Dans l’ensemble, toutes les juridictions du monde ont du mal à suivre le rythme d’une technologie en évolution rapide. Il en va de même pour l’application des lois. Pensez à tout ce que les grandes entreprises technologiques ont pu se permettre dans l’Union Européenne. Je m’oppose souvent au récit selon lequel les États africains sont des institutions défaillantes et qu’il existe un Far West réglementaire dans l’économie numérique du continent. Le contraire est vrai.
Vous avez choisi une approche ethnographique pour raconter cette histoire. Qu’est-ce que cette méthode vous a permis de voir qu’une analyse purement économique ou politique aurait pu manquer ? Quelles étaient ses limites ?
L’ethnographie est une modalité de recherche et d’écriture puissante, en ce qu’elle relie les forces historiques et structurelles aux biographies quotidiennes de ceux qui naviguent avec et contre le courant de ces forces. La qualité unique de l’ethnographie est la nature inévitablement anecdotique et observationnelle des histoires à travers lesquelles des faits plus petits parlent de trajectoires historiques plus larges. Ce faisant, elle soumet d’autres formes d’analyse à un examen empirique. Tout comme d’autres formes d’analyse complètent l’ethnographie avec des formes d’abstraction plus larges.
Bien sûr, l’ethnographie a ses limites. C’est, par définition, une perspective partielle et située. Mes recherches à Nairobi se sont souvent limitées aux espaces de l’élite technologique — les hubs d’innovation, les cafés branchés et les enclaves de la classe moyenne. Cela signifie que ma vision de la vie numérique de la ville est vue à travers une fenêtre d’expertise spécifique, et il y a beaucoup d’”ailleurs” à Nairobi même — les établissements informels et les arrière-pays ruraux — qui restent en marge de cette histoire particulière.
Pour l’avenir, quelle est selon vous la prochaine grande frontière de « l’expérimentation » pour la Silicon Savannah de Nairobi ? Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à sa capacité à forger un avenir technologique véritablement autonome et équitable ?
Je ne suis pas dans le domaine des prédictions, mais je peux dire que la finance et la fintech en particulier sont des arènes en évolution rapide où de nombreuses expérimentations ont lieu — de la dédollarisation des économies africaines à la création de formes d’insubordination financière, comme mon ami Chris Mizes et son équipe à la Sorbonne l’explorent.
Marion Moreau